Alors que l’évolution toujours constante des logiciels de programmation remodèle sans cesse l’organologie, ces nouvelles approches techniques vont de paire avec une esthétique toute particulière : elle devient miroir des consciences collectives concernant l’art numérique.
Publié avec notre partenaire Nonfiction.fr et écrit par Camille Drouet
C’est grâce à la récurrence de certains signifiants et références aux mouvements artistiques antérieurs que les « plasticiens du son » font des interfaces graphiques projetées sur scène un domaine d’étude privilégié. Si l’image est là pour accentuer l’idée « d’être au son » en soulignant la composition, elle s’étudie aussi comme élément à part entière. Comme nous le verrons dans ce texte, l’outil technologique, ses usages et ses discours deviennent de véritables références pour qu’advienne une imagerie collective propre au numérique. La fusion entre univers sonores et visuels que les dispositifs de notre étude tendent à entretenir relève de processus créateurs insolites, d’instruments et champs de création sonore neufs mais laissent avant tout place à de réelles interrogations concernant l’image en régime numérique. Comment l’image en régime numérique se construit-elle? Sur quel discours esthétique peut-elle s’ancrer? Dès les années 70, Etienne Souriau qualifie en ces termes les premières tentatives d’un rapprochement image/son :
« N’oublions pas que les arabesques que nous trouvons ainsi ont les spécialisations dans l’espace d’une idée esthétique originellement spécialisé pour être donnée dans la durée. » .
Il en ressort déjà un goût pour la ligne et l’abstraction du modèle. Cette idée se développe jusqu’à aujourd’hui grâce à une programmation en constante évolution. L’esthétique utilisée tire son inspiration des techniques dites du mangling (broyage) ou encore du crunching (moulinage), initiées sous le mouvement glitch. Cet aller-retour constant entre support de composition et créations de signes et formes en temps réel participent à l’émergence d’une œuvre visuelle inattendue. Ces informations visuelles constituent pour le spectateur autant de repères, ou au contraire non-repères, nécessaires pour prendre pleinement conscience de la composition. L’interface graphique devient alors elle-même source rythmique pour la pièce.
Nous tacherons ici de discerner les modalités esthétiques quant aux visuels développés lors des performances. Les définir comme outil nécessaire pour une réflexion concernant l’image numérique dans le cadre du jeu scénique nous permettra d’explorer les possibles potentialités d’expression esthétique. Cet ensemble nous conduira, à terme, à définir ces créations plastiques comme puisant directement son inspiration du mouvement glitch, défendu par Kim Cascone comme une tendance à une esthétique de l’échec.
L’esthétique glitch, ou la représentation nécessaire d’un échec relatif : concept et histoire du mouvement glitch
L’ensemble des productions étudiées trouve leur définition dans une esthétique sonore et visuelle toute particulière, apparue dans les années 90 : le mouvement glitch. Ce dernier se définit par une totale remise en question des potentialités techniques de l’objet technologique et de ses usages au travers de perturbations et parasitages sonores et / ou visuels. On rompt avec l’idée d’une possible autonomisation totale de la techné. Les partis pris sonores et esthétiques reposent sur un dysfonctionnement pure et simple de la matière en proposant une série d’artefacts. L’attachement aux paysages sonores industriels et une réflexion autour des modes de production et reproductivités qu’induit le numérique, tirent leur inspiration directement du mouvement futuriste du début du XXème siècle. A cet effet, le progrès industriel et l’innovation représentent de véritables champs d’expérimentation. Les moteurs, systèmes d’amplification de la machine, les bruits de la ville deviennent sources d’intérêt. En tenant compte du sonore dans la cité, l’artiste intègre à sa production et à son discours des phénomènes de changements perceptifs redéfinissant, par conséquent, les repères de l’auditeur et du spectateur.
Outre la référence aux recherches de Luigi Russolo , le rapide développement des logiciels de programmation ajoute une réelle esthétique, toute particulière aux créations issues du glitch.
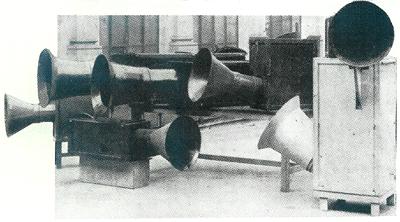
L’exploration de nouveaux territoires sonores, par une organologie novatrice, ouvre à une multitude de potentialités techniques et esthétiques. Les moyens de production de l’œuvre deviennent intrinsèquement liés à la diffusion live, mais aussi aux moyens de distribution, poussant les auteurs à envisager de nouveaux univers musicaux et visuels en surmontant les fonctions assignées à la machine. Alors que l’organologie est régie par les différentes lois de programmation, ces mêmes impératifs techniques font dorénavant l’objet d’un jeu entre l’instrument-machine et le compositeur. C’est véritablement autour de l’idée d’un irrévocable dépassement de la loi que le mouvement glitch ancre son propos. L’information à la sortie (output) n’est pas celle attendue par l’auditeur, ou tout du moins, pas celle prévue par la machine. Son rendu est ralenti voir totalement brouillé, comme un crash technique. Le glitch prend sa source dans un rapport privilégié entre processus technique de la machine et geste de composition. L’œuvre numérique n’est plus conditionnée par une programmation et un contrôle régulier de ses interfaces. L’expérimentation de la matière sonore et visuelle relève de la déconstruction des fichiers digitaux. L’information ou le fichier audio et / ou visuel employé se réduit à sa forme la plus simple, reflétant un univers sonore dépouillé, une plasticité tranchée. Cette remise en question de l’économie de l’attention par effet de parasitage pousse Olivier Quintyn à envisager l’outil numérique comme objet non neutre, constitué et ramifié par son dispositif technique.
« L’outil numérique n’est en effet jamais neutre, il implique des formes de vie avec leurs normes explicites et implicites, voire des formatages que son dysfonctionnement calculé vient soudainement mettre au jour ou révéler. (…) Tout se passe comme si l’attention neuve accordée à la défaillance ouvrait des brèches dans les routines qui cimentent nos interactions quotidiennes avec des appareils digitaux, à quelque place de la chaine de production et de réception qu’on se situe. » (Ibid p. 189)
Les processus de création glitch, reposant sur la création d’artefacts grâce à un dialogue novateur entre geste de composition et technologie, réfute définitivement une standardisation lisse de l’organologie numérique. On cherche alors à révéler la complexité des réseaux qui constituent l’instrument et sa programmation. Cette manifestation de l’échec s’illustre par une totale transparence des procédés digitaux, conduisant ainsi tout spectateur à penser l’œuvre numérique en tant que dispositif technique à l’épreuve de sa propre reproductibilité.
Trois catégories, ou univers, musicaux sont à relever au sein du mouvement. Il faut pourtant souligner leur porosité au regard du nombre de possibilités techniques envisagées.
Au milieu des années 80, le japonais Yasunao Tone retient l’attention dans une période post-Fluxus. Ses recherches acoustiques donneront naissance par la suite au sound-art, particulièrement présent dans les sculptures, vidéos et films expérimentaux. Le travail de la matière sonore poursuivra son évolution autour de figures reconnues telles que Ryoji Ikeda, Carsten Nicolai ou encore Taylor Deupree, ayant recourt à des tonalités plus agressives. L’utilisation de bruits blancs ou le travail autour des hautes fréquences laisse entrevoir un paysage sonore totalement saturé proche du chao. L’approche déconstructiviste est définitivement adoptée par ces compositeurs.
Enfin, l’ambient glitch relève, à l’opposé des deux autres catégories, d’une stratégie compositionnelle plus proche de la pop et du rock. Les textures sont plus harmoniques grâce à l’utilisation de patches Max/MSP permettant un univers sonore mixte, moins brut. Ces expérimentations contribueront à élargir les possibilités picturales et esthétiques en sein des arts plastiques. On assiste à une théâtralisation du contenu grâce à une visualisation des données et des bases de données avec le Net-art, les œuvres bitmap, ou encore le data-mapping. La focalisation de l’œil et de l’oreille est totalement influencée par des modes colo-métriques amplifiés ou des nappes sonores retravaillées en studio. Au fur et à mesure de son épanouissement dans le champ artistique contemporain la signature glitch devient synonyme de paysages industriels, de mélange d’aiguës, de sinusoïdes, de couches rythmiques discordantes, de son dits « bruts », de visuels fluorescents et géométriques. On l’aura donc compris, l’engouement pour l’échec constitue la réflexion première du glitch.
L’échec n’est pas ici à comprendre comme le veut l’esthétique romantique : celle de l’artiste surmené dans sa tentative de représenter la beauté ineffable du monde qui l’entoure. Ici, il est en effet question de traiter directement de la dépendance au modèle technique et au dépassement de ce dernier. Le glitch, se reposant encore une fois entièrement sur les disfonctionnements du modèle technologique, fonde sa critique au travers d’une résistance active à une programmation lisse. En se libérant des chaines que lui impose l’objet technique, l’auteur renouvelle sa composition en repoussant toujours plus loin les potentialités du dispositif. Concevoir l’échec comme figure inévitable pour une remise en question totale de la techné, laisse entrevoir une nouvelle définition du beau. Le mouvement s’impose alors comme pratique autocritique de la culture technologique et numérique. C’est cet envers de la machine que l’on cherche à montrer. Ce qui était jusqu’alors caché est révélé au grand jour. Ce parti pris est non sans rappeler l’architecture du Centre Georges Pompidou conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, en 1971.
La façade révèle au grand jour les structures internes du dispositif architectural. Ce qui était alors caché tel les tuyaux d’aération, les charpentes, bref tout ce qui constitue l’ossature d’un bâtiment se révèle, réinventant par la même le beau architectural. Le propos reste le même pour le glitch : il faut détruire l’enveloppe du dispositif en étalant ce qui constitue l’architecture interne de l’organologie technologique et par la même construire de nouveaux artefacts. Montrer les réseaux internes, déshabiller l’enveloppe externe, déballer les procédés de création ce que l’on cherche absolument à cacher renverse définitivement l’idée d’une techné toute puissante. Dans un article à valeur de manifeste sur le mouvement, Kim Cascone soulève la thèse d’un abandon définitif d’un dispositif technologique tout puissant :
« L’esthétique « post-digitale » s’est développée notamment à partir de l’expérience quotidienne, au travail, d’une immersion dans des environnements saturés par les technologies digitales (…) De fait, « l’échec » est devenu, à la fin du XXème siècle, une esthétique majeure dans de nombreuses formes d’art, pour nous rappeler que notre maitrise de la technologie n’est qu’une illusion, et nous révéler que les outils digitaux ne sont pas plus parfaits (…) ».
L’esthétique glitch, tant sonore que visuelle, repose sur une malléabilité du support et un jeu constant avec les lois qui cadrent le dispositif. Appliquée à notre étude des « plasticiens du son », elle se traduit par un jeu sur les teintes colorées, un système d’informations visuelles reposant sur des formes abstraites, le tout évoluant aux grés des distorsions et dysfonctionnements sonores de la composition. Si la loi informatique dirige l’œuvre et son processus créateur, c’est véritablement grâce à un nouvel emploi de la loi elle-même qu’apparaît à son tour l’idée d’imagerie collective relative à son discours. Comme nous le verrons par la suite, ce concept défendu par André Gunthert répond pour le cas du glitch à des modèles très spécifiques. L’abstraction de la composition sonore se répercute très clairement sur ce qui est projeté vers l’œil. Avant tout, on relève une porosité flagrante entre premier et second plan d’action et d’attention. Un attachement tout particulier pour la grille est aussi à relever, établissant alors un lien direct avec les interfaces de programmation que les compositeurs utilisent pour les performances de notre étude. L’historienne de l’art Rosalind Krauss place la grille comme figure précise d’une rupture opérée entre surface et réel.
« La grille se pose en emblème de la modernité précisément en ceci qu’elle est la forme omniprésente dans l’art de notre siècle : une forme qui n’apparaît nulle part, (…) la grille affirme l’autonomie de l’art : bidimensionnelle, géométrique, ordonnée et est antinaturelle, antimimétique et s’oppose au réel. »
L’apposition d’une grille ouvre à une répétition sans cesse des figures abstraites. Elle balaye l’apparition du réel en brouillant les repères visuels, de la même manière que les distorsions et amplifications sonores du côté de la composition. La grille devient alors métaphore du modèle technologique en soulignant le caractère immatériel, grâce à l’abstraction, de ses interfaces et de ses univers de programmation.
Le mouvement glitch aujourd’hui : une démocratisation par une définition esthétique toute particulière de l’imagerie numérique
Si cette esthétique sonore toute particulière, née au début des années 90, dénombre les limites et disfonctionnements technologiques, qu’en est-il aujourd’hui? On assiste depuis 2010 à une réapparition du mouvement par la multiplication de référentiels. Un réel engouement est assurément à souligner autour de la philosophie glitch qualifiée de « (…) tactique de résistance active, et inscrit(e) dans un mouvement de contestation critique interne des impensés et des pouvoirs de la technologie. » .
Olivier Quintyn décrit ce phénomène comme l’édification d’une utopie. La réification des techniques et esthétiques sonores, tout à fait perceptible dans certaines productions de nos « plasticiens du son », prépose une organisation du discours artistique unique. Ainsi, la référence permet d’asseoir leurs propos tout en inscrivant leurs productions au sein d’une histoire des arts numériques. Pour autant, la perspective d’un principe de résistance et remise en question active des dispositifs technologiques ne constitue plus une place privilégiée pour nos auteurs.
Réinterroger un dispositif technique constitue bien l’un des points forts, mais ne prépose pas pour autant une expérimentation aussi poussée que celle entamée dans les années 90 concernant par exemple les installations interactives. Il s’applique cependant aux concerts / performances live comme les créations de Rioji Ikeda et Super Color Palunar (Jérôme Noetinger et Lionel Palun). Le non-contrôle et la tentative d’épuisement des procédés techniques sont très vite remplacés par un idéal esthétique faisant office de référence ultime. Quintyn souligne alors l’obsolescence programmée du modèle glitch. Ce dernier repose sur une contradiction : s’émanciper de la machine par une réinterprétation du geste compositionnel tout en proposant une réinvention du modèle technique. L’édification d’une nouvelle esthétique dépend donc de la structure « socio-technique » de la machine.
Du fait de la réification par les auteurs contemporains, le glitch ne peut que devenir système autoréférentiel. L’erreur, jusqu’alors considérée comme concept novateur, est rapidement récupérée comme signature et affiliation à une histoire révolue. Peu à peu, le glitch figure non plus comme concept discursif mais véritablement comme genre à part entière, récupéré par les industries culturelles. Il suffit d’entrer dorénavant l’expression dans une barre de recherche pour véritablement s’apercevoir de son institutionnalisation. Il ne représente plus un mouvement musical (remplacé par la musique noise) mais est définitivement dédié à une esthétique plastique. L’insertion dans les logiciels de programmation de patches glitch enterre définitivement ses qualités contestataires. Le mouvement d’avant-garde a laissé place à une véritable signature propre à l’art numérique.
Les « plasticiens du son » placent leurs réalisations dans cet entre-deux : la référence varie en fonction des générations (affiliées officiellement ou non au mouvement) ou par l’emprunt de codes symboliques afin de consolider une reconnaissance avérée par l’amateur. Alors que Rioji Ikeda reste l’une des figures tutélaires du mouvement, d’autres comme Caandides ou encore Jeff Mills empruntes l’esthétique uniquement à des fins scénographiques. Ils n’envisagent pas une recherche sonore contestataire et critique. La performance de Lionel Palun et Jérôme Noetinger reste vraisemblablement l’un des dispositifs les plus glitch. On retrouve alors ce goût pour les larsens et une structure sonore et visuelle défragmentée. Concernant les installations interactives de Miguel Chevalier et Jacopo Baboni Schilingi, c’est encore une fois la référence plastique numérique qui prime sur la recherche acoustique dite glitch.
Il convient alors de se pencher sur le cas de cette imagerie collective propre au numérique qu’a fait naitre ce mouvement d’avant-garde. Celle-ci permettra ainsi d’ancrer notre propos concernant les choix plastiques au sein des installations et performances étudiées qui seront présentées dans une seconde chronique.
Retrouvez toutes nos chroniques électroniques sur Nonfiction.fr